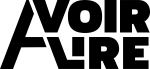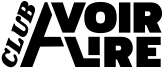Le 18 août 2024

- Réalisateur : Mamadou Dia
- Festival : Festival cinémas d’Afrique de Lausanne 2024
Au sortir de la projection de son nouveau long-métrage Demba, Mamadou Dia nous partage ses secrets de production, son parcours, et sa vision du cinéma sénégalais, dans un entretien riche et animé.

- © FCA Lausanne
Il vient de présenter son second long métrage (réussi) au Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne. Loquace pour notre plus grand plaisir, Mamadou Dia aborde avec calme son film, qui succède au succès du Père de Nafi, en 2019. Cette fois, il s’attaque au sujet de la dépression, en écho à la situation personnelle qu’il a traversée à l’adolescence. Son film sera distribué en France, sans date de sortie précise pour le moment.
aVoir-aLire : J’aimerais d’abord vous demander comment vous en êtes venu à réaliser des films, ce qui vous a motivé ? J’ai lu que vous regardiez des films à la télévision, et que c’est ça qui a déclenché votre envie de cinéma.
Mamadou Dia : Au début je ne savais pas que je voulais faire du cinéma, je ne savais pas du tout… J’aimais bien regarder les films. On n’avait pas de télé chez moi à Matam (ndlr : Est du Sénégal), donc on allait tous chez le voisin. La télévision sénégalaise à l’époque avait un excellent programme. Ils montraient des films américains, des films hindous, européens et beaucoup de films africains aussi. C’est toujours resté dans ma tête. C’est après, quand je suis allé à Dakar, qui est une grosse ville avec plusieurs millions d’habitants, que j’ai eu cette idée de vouloir témoigner de ce que je voyais, comme Dakar bougeait. Je voulais raconter aux gens : c’est quoi Dakar ?
aVoir-aLire : Il y a donc une volonté documentaire au début.
MD : De partager. Je suis allé faire une formation visuelle et communication et j’ai commencé à travailler en journalisme. J’ai beaucoup voyagé en Afrique comme journaliste, et je me suis rendu compte de toutes les histoires qui existent, toutes les Afrique qu’il y a. J’ai pu témoigner, filmer, rencontrer des gens pour des agences internationales. En Afrique on s’attend toujours aux mêmes histoires, de coup d’État, de problèmes politiques, d’élection présidentielle qui ne marche pas… Je voulais raconter les autres histoires, plus nuancées. C’est sûr qu’on a des problèmes comme tous les autres pays, mais il y a aussi de belles choses qui se passent. Comment raconter l’Afrique de nous-mêmes sans que ce soit imposé par les autres ? C’est un combat très ancien. Le cinéma m’offrait la possibilité de raconter ces nouvelles perspectives, plus complexes.
aVoir-aLire : Quand vous regardiez la télévision du voisin alors que vous étiez jeune, il y a des films ou des cinéastes qui vont particulièrement marqués ?
MD : J’aime beaucoup les cinémas de Sembène, Membety, Sissako, parce qu’ils font des films qui m’ont permis à l’époque de me dire que je pouvais en faire. Mais quand j’ai vu des gens faire des films avec les langues locales, les gens qui me ressemblent, des villages comme les miens, je me suis dit que c’est accessible.
J’aime beaucoup aussi le western, qui a ce côté très facile à comprendre quand on est jeune. Tu sais qui tu dois supporter. En plus, à l’époque on ne parlait pas la langue. Le français est seulement appris à l’école. Tous les films étaient doublés en français, sauf les films en hindi.
aVoir-aLire : Mais à Matam, dans votre ville, vous parliez français ?
MD : Non, pas vraiment. À la maison on parle le peul. Je découvre le cinéma avec les images et le son. Cela a inspiré mon premier travail, un court qui s’appelle Samedi cinéma (2016). Je traduisais les lettres en français à l’époque, car j’apprenais le français à l’école, où on parlait exclusivement le français.
aVoir-aLire : Donc vous avez déjà redécouvert un film que vous aviez découvert sans comprendre les dialogues ?
MD : Bien sûr ! Parfois d’une manière très décevante. Parfois j’imaginais, j’imaginais, et je me suis rendu compte que ce n’était pas ça du tout…
aVoir-aLire : Vous avez donc commencé avec le documentaire. Comment êtes-vous passé de l’image purement journalistique à l’image purement fictionnelle ?
MD : À New York. J’ai fait mon master là-bas. Dans le journalisme, il y a un biais. Alors que dans le cinéma le biais s’assume. Je choisis mon cadre. Je fais mon montage, j’écris mon scénario. C’est ce que j’aime beaucoup dans le cinéma. Le cinéma, c’est assumer que les biais, les partis pris, deviennent ma force. Je les choisis. Ils ne sont plus ma faiblesse.
Mais à la base, j’aime beaucoup les images. Mon idée, c’était de faire chef opérateur. À New York, c’est la première fois que je voyais des acteurs professionnels. Pendant les exercices de réalisation, des acteurs venaient et je voyais ce qu’ils pouvaient faire avec le texte. Je voyais ce qu’une page pouvait devenir en chair et en os. Je suis complètement tombé amoureux des acteurs. J’ai commencé aussi à écrire plus, et à réaliser plus. C’est comme ça que la fiction est devenue concrète pour moi.
aVoir-aLire : Donc vous avez toutes les palettes, écriture, chef opérateur en devenir, et donc l’œil du réalisateur. Cela influe sur notre manière de faire, aujourd’hui ?
MD : Disons que ça aide, car on sait où sont les limites qu’on peut demander. Mais je fais confiance au chef opérateur par exemple, c’est une collaboration avec Sheldon Chau. On sait aussi ce que ça représente, la présence d’une caméra avec un acteur non professionnel. Dans notre équipe il y a une majorité d’acteurs non professionnels.

- © 2020 The Party Film Sales. Tous droits réservés.
aVoir-aLire : Comment vous avez géré les acteurs non professionnels ? Différemment des acteurs professionnels ?
MD : C’est beaucoup de temps. Ben Mahmoud (ndlr : qui joue Demba) et moi, on se connaît très bien. Nos mamans étaient des amies. On a tous les deux vécu cette expérience de perdre notre mère, cette dépression, ce deuil. Il faut donc discuter avec lui, et laisser aux acteurs le soin de discuter les scènes. Ce sont donc plusieurs semaines d’ateliers avec eux où on discute. Chaque scène est vraiment ouverte. Rien n’est imposé, et ce sont parfois les acteurs qui disent que cette séquence-là, moi je pense que je devrais me lever, ici je pense que c’est comme ça que je devais lui répondre. Il faut trouver des gens qui se rapprochent des personnages. Je dirais qu’une bonne partie du film a été ajustée. Je ne sais pas transformer un acteur en ce qu’il n’est pas. Donc la seule chose qui marche c’est de rapprocher le scénario à ce qu’ils sont.
aVoir-aLire : Il y a eu Le père de Nafi (2019) en premier long. Il a obtenu pas mal de succès, avec par exemple le Prix à Locarno. Comment l’avez-vous reçu, ce succès a-t-il changé votre manière de faire des films ?
MD : Il est sorti juste avant la COVID au Sénégal. Il a fait plusieurs festivals, je dirais une centaine. C’était vraiment un plaisir de voir ça et de voir un film qui était auto-produit localement, avec rien du tout. Le seul soutien qu’on a eu, c’est après le tournage ou avec le soutien de l’État du Sénégal, pendant qu’on tournait. C’est presque totalement sénégalais, à part Canal+ qui nous a aidé. Et on représente le Sénégal aux Oscars, donc on était fiers. On a suivi le même processus avec Demba, avec un peu plus de moyens. On a eu quelques coproductions, mais en postproduction. Il y a la Suisse, le Qatar, l’Allemagne. Mais tous ces pays, ça ne fait pas 10 % du total. On a beaucoup cherché à peser sur le système des festivals, qui a été une grande aide. Après notre montage, on a été sélectionnés au festival de Berlin. Et on a The Party films sales, en France, qui s’occupe de la vente du film. Les fonds publics du Sénégal nous ont aidés aussi.
aVoir-aLire : Au Sénégal, et à Matam, comment vos films sont-ils reçus ?
MD : À Matam, c’était la première fois pour beaucoup qu’ils voyaient un film sur grand écran (ndlr : pour son film précédent). Il n’y a plus de cinéma depuis les années 90 je crois. C’est là qu’a toujours lieu la Première nationale. On utilise un écran gonflable et on va dans les autres villes aussi, à Saint-Louis, Thiès, Dakar… Pour Demba, on commence en décembre.
aVoir-aLire : Vous abordez la question de la dépression dans votre nouveau film. Comment se déroule le débat autour de cette question au Sénégal ?
MD : C’est un débat qui a besoin d’être beaucoup plus démocratique. On en parle peut-être en famille mais en dehors de cette cellule familiale, pas trop. Il y a quand même l’hôpital psychiatrique de Fann, qui a fait beaucoup de travail depuis des décennies. Il y a toujours cette incompréhension de la santé mentale. On a l’impression que soit on est fou, soit on ne l’est pas. Donc quand on n’arrive pas à ce stade où l’on a des signes extérieurs de santé mentale, les gens ne le reconnaissent pas. C’est ça qui nous intéresse, ramener le débat, le démocratiser. Les gens en parlent beaucoup plus maintenant, il faut continuer à faire en sorte que ce ne soit plus un tabou.
aVoir-aLire : Vous mentionnez un centre de thérapie dans le film. C’est quelque chose que vous avez vu arriver quand vous étiez jeune, ou que vous auriez aimé avoir ?
MD : Il est fictionnel. Ce qui nous intéresse dans un pays comme le Sénégal, c’est ce pont entre ceux qui vont voir le guérisseur et ceux qui vont au centre. Souvent, ce sont les mêmes gens. Les mêmes qui ont un âne et une voiture chez eux aussi. Je ne les oppose jamais. Je pense qu’il existe des centres qui allient les deux, par exemple la médecine orientale et la médecine occidentale.
aVoir-aLire : Vous dites aussi que si on ne va pas dans ce centre, alors il fut faire une journée de trajet pour aller à Dakar. Cet éloignement était un sujet majeur que vous souhaitiez aborder ?
MD : Maintenant, il y a une belle route qui nous amène à Dakar en six ou sept heures. Mais quand j’étais jeune, il fallait presque une journée pour aller à Dakar ! C’était vraiment la croix et la bannière Donc moi j’ai grandi dans cette idée que le politique est toujours très éloigné, qu’il vient chez nous seulement quand c’est la campagne électorale. J’ai toujours quelques coups pour les politiciens parce qu’on a toujours senti qu’on était oubliés. On appelle ça un système macro-céphalique : grosse tête à la capitale, et petit corps. Encore aujourd’hui, il y a des choses qu’on peut seulement faire à Dakar. Cet éloignement, il est toujours resté en moi.
aVoir-aLire : Le personnage de Demba est en dépression suite au deuil de sa femme. Mais on voit aussi qu’il a du mal à s’adapter au monde, la digitalisation notamment. Vous pensez qu’il aurait pu souffrir d’une dépression sans ce deuil ?
MD : Il est dépressif au départ, et puis il y a des éléments déclencheurs. Un élément qui aggrave la situation. Comme une maladie dormante qui se réveille. Et le personnage du maire le pousse à la retraite à cause de sa dépression, et parce qu’il ne s’adapte pas bien. Et c’est un cercle vicieux… Dans la dépression, la manière dont on te traite et dont le monde extérieur te traite a une grande importance.
aVoir-aLire : Il y a une sorte de paradoxe dans votre film, qui est résumé un peu dans votre scène finale. Et même dans la photo, très chaude, un peu enveloppante, qui en fait on nous raconte des événements mortifères…
MD : Le malheur de la dépression c’est le suicide. Or pour les dépressifs, c’est vu comme une liberté. L’idée est de cette fête, c’est toujours cette idée de communauté. Parce que dans mon expérience de deuil, c’est la communauté qui m’a aidé. A la fin, il faut que Demba renaisse, car le Demba qu’on a connu ne peut plus exister. Donc on célèbre la mort. Dans cette société, la mort ne fait pas peur. Quand quelqu’un est malade ou vieux, qu’il meurt, on dit qu’il a eu une belle vie. C’est pas toujours c’est une fin malheureuse. C’est normal, la mort. On trouve toujours des gens au Sénégal qui, quand ils perdent un proche, tiennent à être les consolateurs !

- © 2020 The Party Film Sales. Tous droits réservés.
aVoir-aLire : Dans votre film, Bajjo est intéressant. Il est dans une posture difficile, son père étant en grande détresse. Je me demandais si vous vous identifiiez principalement à lui, sa jeunesse.
MD : Je m’identifie à plusieurs personnages, par fragments. Baggio représente nous tous, qui essayons de nous éloigner de nos parents, et nous rendons compte que c’est l’inverse. Il sait que que cette dépression peut être héréditaire. Il craint de devenir comme son père, mais chaque jour il s’en rapproche. Et son père craint de voir son fils ne pas faire mieux que lui, donc il s’en veut.
aVoir-aLire : Pour élargir, quelle évolution constatez-vous à propos du cinéma sénégalais et plus largement du cinéma africain ? Il y a des films dans ce festival que vous avez vu où aimeriez voir par exemple ?
MD : Je viens de voir le documentaire de Ousmane-William Mbaye (ndlr : Ndar, saga waalo, 2024), un mohican du documentaire. Il s’est donné cette ambition de parler de l’Histoire. C’est l’histoire très puissante de la ville de Saint-Louis, ancienne capitale de l’Afrique occidentale française. Il parle de Saint-Louis dans sa complexité. À mon avis, le cinéma au Sénégal se porte bien. Il a toujours été là. Le grand souci, c’est la diffusion.
aVoir-aLire : Ils sont largement montrés au Sénégal ?
MD : Les courts-métrages sont beaucoup montrés au Sénégal. On fait des films différents aussi, qu’on appelle « théâtre », qui sont beaucoup consommés au Sénégal. Les séries télévisées en ligne sont regardées sur les télévisions privées, mais ce sont des choses qui ne sortent pas. La production cinématographique est toujours un peu élitiste. Il y a une génération qui se bat à allier les deux. On a une économie de marché à trouver aussi, car avec le seul Sénégal on ne peut pas rembourser les films.
aVoir-aLire : Justement, vous tournez le film en peul. Avez-vous déjà pensé à tourner dans une autre langue, car cela pourrait être un frein ? Ou au contraire, estimez-vous que c’est plus authentique ?
MD : Pour faciliter le jeu d’acteur, j’ai gardé leur nom et leur langue maternelle. Souvent, dans les films ou les séries dans lesquels on force les acteurs à jouer dans une autre langue, par exemple en français, ça se voit… Avec Le père de Nafi, par exemple, Canal+ a été très généreux après des mois de débat : il n’a pas été doublé. Uniquement sous-titré. Cette langue peule est parlée par 60 millions de personnes, dans l’Afrique de l’Est à l’Ouest. Donc pouvoir parler cette langue, c’est très important. Jusqu’à présent je tourne dans la langue que je connais, dans le terroir que je connais. Si je devais tourner mon film dans le sud du Sénégal où on parle diola ou mandingue, je tournerais probablement dans ces langues-là. Le problème de la langue, c’est que ceux qui parlent français sont aussi ceux lisent le français, donc doublé ou sous-titré, c’est la même chose.
aVoir-aLire : Je vais terminer en vous demandant si vous avez en tête de continuer à creuser des histoires sénégalaises, ou si vous aimeriez aussi aller vers d’autres histoires, peut-être revenir au documentaire ?
MD : Je fais encore des films au Sénégal parce que c’est le pays que je connais le mieux. Cela fait bientôt dix ans que je suis basé entre Sénégal et les États-Unis, mais je pense que la complexité d’un pays est tellement grande qu’avoir le courage de parler d’un pays qui n’est pas le sien est très difficile. Néanmoins, je respecte beaucoup le point de vue de l’outsider. Celui qui vient de l’extérieur et voit de l’extérieur. Certains films sont faits comme ça et sont magnifiques, réalisés par quelqu’un d’une culture différente. Il a un recul particulier. Pour le moment, on monte un documentaire sur la danseuse-chorégraphe Germaine Acogny, et un autre film de fiction d’époque, à Saint-Louis. Aussi, notre compagnie de production Joyedidi essaie de produire beaucoup de films dans plusieurs pays différents, comme au Kenya.
aVoir-aLire : Un film que vous voulez voir en sortant de cet entretien ?
Camp de Thiaroye ! Et un court, de Ben Diogaye Beye, Les princes Noirs de Saint-Germain des prés (1975) !
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.