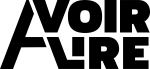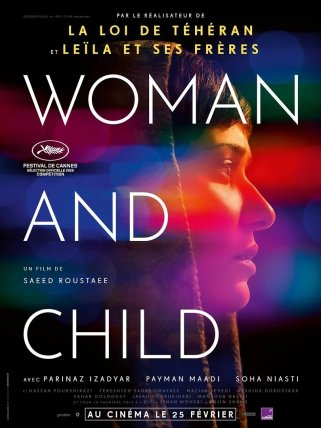Le 2 août 2024
Un premier film touchant, qui refuse tout pathos dans une esthétique proche du néoréalisme.

- Réalisateur : Antonio Pietrangeli
- Acteurs : Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Irène Galter, Pina Bottin, Lia Di Leo
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Italien
- Distributeur : Les Films du Camélia
- Durée : 1h38mn
- Reprise: 12 octobre 2016
- Titre original : Il Sole negli occhi
- Date de sortie : 22 juillet 1955
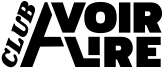
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 1953
Résumé : Celestina est une jeune paysanne qui quitte son petit village pour chercher du travail comme domestique à Rome. Ses différents employeurs profitent de son innocence tout comme les hommes, attirés par sa beauté. Elle se fait courtiser par un jeune plombier, Fernando, dont elle tombe amoureuse et qui disparaît alors qu’elle est enceinte…
Critique : Premier film d’Antonio Pietrangeli, Du soleil dans les yeux suit l’itinéraire d’une provinciale naïve, partie à Rome pour travailler comme bonne. Elle accumule les places, se laisse séduire par un plombier qui mène une double vie. On retrouve là tous les ingrédients du mélodrame, avec le lieu commun de la mère célibataire ; mais en 1953, on est encore proche du néoréalisme : tournage en extérieur, acteurs peu connus ou non professionnels, lumière naturelle ; rien de flamboyant donc, mais au contraire une approche très réaliste (malgré l’habitude de l’époque en Italie de post-synchroniser l’ensemble des dialogues, avec des correspondances aléatoires entre paroles et mouvements des lèvres). C’est sans doute ce qui frappe le plus et le film prend par moments des allures de documentaire sur la vie des petites gens au début des années 50. Mais la fiction, bien qu’effacée dans de nombreuses séquences, prend corps dans les personnages, qu’ils soient seulement esquissés (la galerie des familles chez qui Celestina travaille relève parfois de la caricature savoureuse), ou au contraire approfondis : ainsi de Fernando, le plombier séducteur, prototype du lâche prompt à rejeter la faute sur la jeune fille. Dès qu’il est avec elle, il ne veut plus la quitter, mais ses intérêts le poussent vers la sœur de son employeur. Magnifiquement interprété par Gabriele Ferzetti, acteur à l’impressionnante filmographie, il alterne les passages enjôleurs, et ceux où, face aux responsabilités, à l’engagement, il fait défaut ; le moment le plus déchirant à cet égard est sans doute celui où il dit ne pas la connaître alors qu’elle est jetée sous un tramway par désespoir.
Quant à Celestina, elle affronte un destin contraire avec une énergie que ne laisse pas prévoir ses gémissements initiaux ; s’acclimatant peu à peu à la vie romaine et ses pièges, elle sait repousser un « fiancé » hypocrite ou le fils de famille aux mains baladeuses. De nombreux plans la laissent isolée dans un espace déserté et chaque fois c’est un signe d’abandon ou d’attente ; ces échos structurent habilement le scénario, de même que les séquences où elle marche dans les rues, d’abord hésitante et perdue, puis de plus en plus assurée. Pareillement le motif de l’ange, statue abîmée, cassée ensuite sans regret, et enfin réapparaissant métaphoriquement à l’hôpital, redouble son parcours en lui donnant une dimension symbolique.
Mais le plus réjouissant est sans doute les familles qui se succèdent, toutes ou presque empruntes du même mépris à l’égard des domestiques ; ces « bonnes gens » dont les bonnes, à l’image d’un chœur antique, commentent entre elles les comportements, sont snobs, vicieux, ou vulgaires sans rémission. Les seuls qui échappent à cette satire sont un vieux couple désargenté, mais, quand ils veulent léguer un terrain à Celestina, la famille se ligue pour la chasser ; incidemment, le film parle aussi de la lutte des classes, mais de manière amoindrie, sans grand discours ni révolte.
Si le film nous touche encore aujourd’hui, c’est sans doute que Pietrangeli refuse tout pathos et tout lyrisme ; il reste au plus près d’un quotidien banal, accumulant les effets de réel pour donner une belle épaisseur à des situations et personnages qui pouvaient prêter au stéréotype. Et même le dénouement, ouvert et en demi-teinte, participe de cette approche, ce qui le rend encore plus bouleversant. On pense à la fin d’Une vie de Maupassant : « La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on le croit. »
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.