Le monde selon Seidl
Le 22 mars 2024
Un opus foudroyant qui aurait pu mériter la Palme d’or au Festival de Cannes 2008.

- Réalisateur : Ulrich Seidl
- Acteurs : Paul Hofmann, Ekateryna Rak, Maria Hofstätter
- Genre : Drame, Érotique
- Nationalité : Autrichien
- Durée : 2h15mn
- Âge : Interdit aux moins de 16 ans
- Date de sortie : 7 janvier 2009
- Festival : Festival de Cannes 2007, Sélection officielle Cannes 2007 (en compétition)
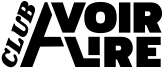
Résumé : Deux trajectoires évoluent dans des directions opposées. Olga, jeune infirmière ukrainienne, part à la recherche du bonheur à l’Ouest où elle devient femme de ménage dans un service gériatrique en Autriche. Paul était agent de sécurité à Vienne. Au chômage, il prend la route avec son beau-père vers l’Est, en direction de l’Ukraine. Deux destins de jeunes gens à la recherche d’une nouvelle chance, qui se voient confrontés à la réalité crue. Deux histoires sur la quête du bonheur et de l’argent, sur le côté effrayant de la sexualité, de la mort et sur l’art de brosser les dents d’un renard empaillé.
Critique : Sur plus de deux heures, Ulrich Seidl, réalisateur intransigeant de Dog days, essentiellement connu pour ses documentaires, entremêle avec une audace inouïe et une rigueur clinique des destins pathétiques et traite de son sujet fétiche : la méchanceté des hommes gouvernée par des jalousies obscures et la lutte pour la survie à travers deux personnages : une demoiselle qui fait les plus
vieux métiers du monde pour avoir une intégrité sociale et un jeune homme sensible, flanqué d’un paternel vulgos, qui doit se confronter à tous les monstres qui l’entourent.
Réfractaires à la neurasthénie, abstenez-vous. Les autres ? Succombez à cet impressionnant vertige qui ne fait pas de cadeau, échappe à la complaisance (alors qu’il est toujours à deux doigts de tomber dedans) et refuse toute larme de crocodile. En dévoilant l’envers abject d’un décor autrichien que Seidl connaît
très bien (la médiocrité autrichienne était déjà célébrée dans son précédent long), le cinéaste lance un uppercut d’une force herculéenne. Qu’il s’agisse de radiographier un hospice où les vieilles personnes alitées sont considérées comme du bétail ou de montrer les restes d’une humanité perdue (lorsqu’une mère et sa fille se prennent dans les bras ou se parlent au téléphone), le film stimule l’affect lacrymal, dérange beaucoup, secoue en possédant cette marque précieuse des œuvres uniques qui n’en finissent plus d’agresser notre sage conscience. C’est rare. Une telle intransigeance et une telle beauté tranchent avec le tout-venant et concourent à rendre cette expérience inoubliable.
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.
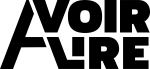
















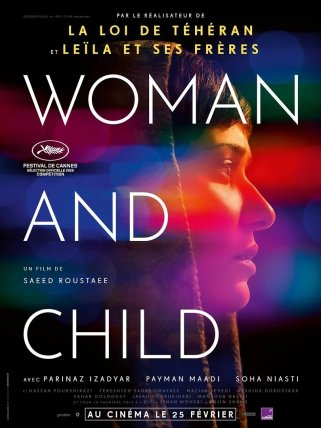




Frédéric Mignard 12 janvier 2009
Import/Export - Ulrich Seidl - critique
Un diaporama un peu statique de scènes réalistes et crues qui plombent l’atmosphère. Du bon cinéma, certes, mais excèssivement monolithique.
On notera que l’affiche est un peu réductrice. Le sexe ne représente qu’un petit quart d’heure d’un film de plus de deux heures...
Norman06 29 avril 2009
Import/Export - Ulrich Seidl - critique
Une description singulière de ces petits détails décalés (gestuelle, accessoires, vêtements) d’un monde faussement simple. Mais le cinéaste pourrait avec fierté revendiquer la filiation d’un Tati pour le cinéma classique et d’un Kaurismäki pour le contemporain. Il est en outre courageux dans sa volonté de filmer sans concessions des personnages et des situations qui suscitent d’ordinaire l’autocensure de ses pairs et le malaise du spectateur, sans sombrer dans le voyeurisme ou le sentimentalisme.