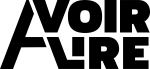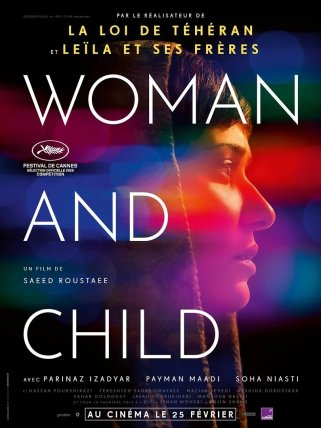Le 19 juillet 2024
Un Chabrol mineur ? Pas si sûr, même si indiscutablement un « grand film malade » au sens truffaldien. L’ambiance décalée et sa satire de la bourgeoisie s’inscrivent pleinement dans l’univers du réalisateur.

- Réalisateur : Claude Chabrol
- Acteurs : Stéphane Audran, Anthony Perkins, Maurice Ronet, Yvonne Furneaux, Dominique Zardi, Henri Attal, Catherine Sola, Denise Péronne, Henry Jones, George Skaff, Christa Lang, Marie-Ange Aniès, Suzanne Lloyd
- Genre : Drame, Thriller
- Nationalité : Français
- Distributeur : Universal Pictures France
- Durée : 1h45mn
- Date de sortie : 31 mars 1967
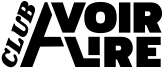
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Paul Wagner dirige une négoce de champagne mais à la suite d’un très grave traumatisme crânien, il n’est plus capable de s’en occuper. Son entreprise devient alors la cible de nombreuses convoitises et des personnes commencent à être assassinées ! Les soupçons de la police se tournent alors vers Paul...
Critique : Après Le beau Serge et Les cousins, Claude Chabrol était apparu comme l’un des jeunes cinéastes les plus prometteurs de la Nouvelle Vague. Mais la première moitié des années 1960 devait apparaître décevante dans la carrière du réalisateur, qui semblait prendre une voie plus académique (Landru) voire franchement commerciale (Marie-Chantal contre le docteur Kha). Après le méconnu La ligne de démarcation, Chabrol se lança dans ce qui sera sa marque de fabrique : le polar distancié à connotation psychologique, avec une lourde charge contre la bourgeoisie. Coécrit par Claude Brulé et Derek Prouse, sur des dialogues du fidèle Paul Gégauff, Le scandale a été produit par la filiale française d’Universal. Le film fut un lourd échec public, et ne reçut guère d’indulgence critique à sa sortie. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. En premier lieu, la narration est assez complexe et tarabiscotée, ce qui n’est pas un problème quand le produit final se nomme Le grand sommeil ou La dame de Shanghaï, mais n’est pas suffisamment compensé ici par une attraction stylistique. En fait, le scénario flirte avec la vogue du film de manipulation que le cinéma français avait initié avec Les diaboliques, et avait conduit à plusieurs réussites dont le sous-estimé Piège pour Cendrillon (Cayatte, 1965). Mais des failles d’écriture font qu’on peine parfois à s’intéresser aux déboires des trois protagonistes. Paul Wagner est l’actionnaire principal d’une société de champagne. Victime de troubles psychiques depuis une agression, il doit subir l’insistance de son associée, Christine, qui veut vendre l’entreprise. Celle-ci est mariée à un Américain, Christopher, par ailleurs meilleur ami de Paul dans ses soirées d’amusement. La suite est un jeu de tromperies où des meurtres de jeunes femmes et un mystérieux chantage semblent mener sur plusieurs pistes. En second lieu, Anthony Perkins manque un peu d’épaisseur pour le personnage de Christopher. Le mémorable interprète de Psychose, qui avait apprécié de tourner pendant plusieurs années en France, aurait été imposé par Universal, tout en ayant eu la validation de Chabrol, grand admirateur de Hitchcock. Les deux hommes se retrouveront d’ailleurs quatre ans plus tard avec La décade prodigieuse.
Et pourtant, Le scandale mérite d’être redécouvert et se présente comme un archétype du « grand film malade » défini par Truffaut, c’est-à-dire une œuvre qui aurait pu être sublime mais est gâchée par quelques imperfections. Quelles sont alors ses qualités ? En premier lieu, l’univers chabrolien est bien en place, avec ses héritières cupides, ses patrons étriqués, ses nantis cyniques. Chabrol aime croquer une certaine bourgeoisie de province : en ce sens, Le scandale annonce les futures indiscutables réussites telles que La femme infidèle ou La cérémonie. En second lieu, tout cinéphile se ravira des références hitchcockiennes, du générique à la Saul Bass au double rôle (blonde et brune) tenu par une interprète. En troisième lieu, la mise en scène a tout de même de l’allure, avec des passages audacieux (le pré-générique, le plan final). Il faut ici souligner le talent des collaborateurs artistiques et techniques de Chabrol, dont Pierre Jansen, pour une étonnante partition baroque qui accentue le climat d’étrangeté. En quatrième lieu, le reste du casting est impeccable, à commencer par Maurice Ronet, qui reprend un peu son personnage de Plein soleil, le duo Paul-Christopher rappelant d’ailleurs (en moins trouble) celui que l’acteur avait formé avec Delon dans le film de Clément. Yvonne Furneaux au regard faussement angélique se meut avec bonheur dans l’univers chabrolien, et l’on peut regretter que cette actrice, à la carrière essentiellement anglo-italienne, n’ait pas davantage été utilisée par le cinéma français. Le trio de vedettes est bien épaulé par une brochette de seconds rôles inspirés, de Stéphane Audran (future muse du cinéaste) en maîtresse intrigante à Denise Péronne en ex-protectrice, en passant par la Canadienne Suzanne Lloyd en sculptrice mondaine.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.