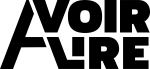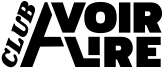Le 7 janvier 2026

- Réalisateur : Martin Scorsese
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Deuxième service. Après avoir consacré un copieux ouvrage à Steven Spielberg, Olivier Bousquet, Arnaud Devillard et Nicolas Schaller remettent le couvert et s’attaquent cette fois encore à l’une des figures les plus révérées de la cinéphilie mondiale : Martin Scorsese. La violence et la foi, l’ordre et le désordre, le bien et le mal : avec deux d’entre eux, on a évoqué ce qui occupe et préoccupe le cinéaste depuis toujours.
Qu’avez-vous (re)découvert en vous replongeant dans l’œuvre de Martin Scorsese pour ce livre ?
Olivier Bousquet : On n’avait pas tous le même rapport à Scorsese, puisque Nicolas est un de ses exégètes, quand j’ai plus de distance avec ce cinéaste. Ce qui n’était pas mon cas pour Spielberg, un réalisateur qui a accompagné mon enfance et mon éveil au cinéma. J’avais vu les classiques scorsesiens, ainsi que quelques mauvais films. En me plongeant dans son œuvre, j’ai été stupéfait par sa cohérence. C’est ce qui est intéressant avec ce genre de livres : même les films qui semblent un peu à part dans une filmographie ont un lien très fort avec leur auteur.
Nicolas Schaller : On peut voir du cynisme, du moins de l’opportunisme, quand un cinéaste cherche à réaliser un film plus commercial pour se remettre en selle, mais cela ne veut pas dire qu’il ne va pas chercher un matériau qui le touche et lui parle. Même dans ses films initiés par Leonardo DiCaprio, Scorsese finit toujours par en faire quelque chose de personnel, qui prolonge ses marottes et ses obsessions. Le Loup de Wall Street, qui est une version presque parodique des Affranchis sur une autre époque et dans un autre domaine, raconte la même chose : l’Amérique, l’argent, le matérialisme, l’absence de valeurs, la corruption.
Pour en revenir à la question, ce que j’ai aussi vu en me replongeant dans l’œuvre, c’est l’évolution constante de Scorsese. Il décline des motifs tout au long de sa carrière mais son regard grandit sans cesse. Sur la question de la spiritualité – la foi est une question centrale chez Scorsese –, il part de ses premiers films, nourris de symboles chrétiens et par un sentiment très personnel de culpabilité, pour aller vers La Dernière tentation du Christ, une vision insolite et critique de Jésus, puis Kundun, film sur le bouddhisme, et Silence, sur des missionnaires catholiques dans le Japon du XVIIe siècle. À chaque fois, il y a une évolution dans l’approche de la religion. Scorsese se pose toujours des questions : sur sa foi, sur lui-même, sur ses précédents films. Il a toujours été d’une grande honnêteté sur ce qui l’anime comme sur sa période d’addiction à la drogue ou son rapport aux femmes et à la violence. Une aubaine quand on écrit un livre sur lui.
Son rapport à la violence, la façon dont il la conçoit et la met en scène ont beaucoup évolué également.
NS : On lui a beaucoup reproché d’être complaisant avec la violence, ce qui est, selon moi, d’une grande bêtise. Que l’on soit choqué par cette violence, qu’on la trouve parfois insupportable, prouve qu’il a atteint son but, qu’il montre la violence telle qu’elle est, sans complaisance. À ses débuts, cette violence venait à la fois de son vécu et de son envie de cinéma. Il était jeune, plein d’énergie, voulait que la dynamique qu’il avait observée dans les rues de Little Italy transparaisse à l’écran et nous explose à la face !
Dans Mean Streets, c’est une violence de cour d’école, presque ludique, car les personnages sont des petites frappes ; dans Les Affranchis et Casino, cela devient beaucoup plus sérieux, institutionnalisé, néfaste. Le réalisateur cherchait à montrer à la fois la réalité de cette violence et la fascination qu’elle entretient chez le spectateur. Scorsese, au fond de lui, est un moraliste : il ne fait pas la morale mais a une vraie vision morale des choses. Dans Killers of the Flower Moon, la violence ne prend pas la forme d’explosions ponctuelles : elle est partout, pesante, délétère – souterraine mais ancrée au sein de ce clan de terriens blancs. Et ce qui est beau, c’est que Scorsese y met davantage en avant les rituels indiens. Son carburant formel, esthétique, il l’injecte dans ces scènes plutôt que dans celles de violence. Parce qu’il a vieilli, et parce que ce parti pris est plus adapté au sujet du film : la violence raciste, originelle, systémique, de l’Amérique. Cela dit, ce qui est amusant, c’est qu’il a fait Le Loup de Wall Street à 69 ans. Un film obscène, vulgaire, dans lequel il se lâche totalement ! On y trouve une autre forme de violence : celle, du capitalisme, du monde de la finance, de la galvanisation et de l’humiliation des foules par l’argent. Donc, oui, le traitement de ce thème évolue chez Scorsese en qui certains s’obstinent encore à voir un cinéaste aussi macho et brutal que ses personnages de mafieux.
OB : Dans The Irishman, par exemple, il y a un contrepoint : le meurtre de Jimmy Hoffa (Al Pacino), que le spectateur sait inéluctable, a lieu pourtant hors champ. Comme si Scorsese se refusait à le montrer. Il peut aussi y avoir la violence psychologique, déjà présente dans Alice n’est plus ici, qui vient juste après Mean Streets. Un film habité par la violence entre les hommes et les femmes, entre une mère et son fils, par la chape de plomb – aujourd’hui, on dirait « charge mentale » – qui pèse sur cette femme.
Dans votre livre, vous revenez aussi sur la question de l’identité, particulièrement italo-américaine chez Scorsese, traitée bien plus finement et subtilement qu’on veut parfois le croire.
NS : Scorsese a été le premier à montrer une réalité sociologique qui n’existait pas au cinéma. Dans Mean Streets ou Les Affranchis, mais surtout dans ses documentaires ; dès 1974, il filme dans Italianamerican ses parents, dans leur appartement, avec ce détail du canapé du salon resté sous plastique qui en dit long sur le luxe que cela représente pour ce couple modeste. Il avait à cœur de transmettre d’où il venait, de faire le lien entre l’Italie et les États-Unis, de montrer dans tous ses aspects la réalité de l’Italo-Américain qui a grandi à New York.
OB : Il explique que, dans son enfance, il avait le choix entre devenir prêtre et devenir gangster, entre l’ordre et le désordre, entre le bien et le mal. C’est un résumé basique mais là réside la matrice de tout son cinéma, dans lequel il a trouvé non seulement le moyen de répondre à ses préoccupations existentielles, mais en plus de magnifier cela via l’art.
NS : Son « italo-américanité » s’est manifestée différemment au fil du temps. Même quand il réalise un film qui n’a rien à voir avec l’italianité ou avec New York, Scorsese adopte toujours un regard distancié, de biais, celui du marginal. Dans Kundun, il arrive à s’identifier au Dalaï-Lama enfant. Pourquoi ? Parce que ce dernier est enfermé dans son temple et observe de loin la violence du monde, comme l’enfant asthmatique, reclus chez lui, qu’était Scorsese, observait la violence de sa rue derrière sa fenêtre.
OB : Et, une fois qu’il a à peu près défini son identité italo-américaine, il s’est demandé ce que c’était qu’être Américain. Il a alors exploré les racines d’un pays âgé de deux cents ans, à peine construit…
NS : Le basculement, dans son cinéma, entre Robert De Niro et DiCaprio peut être vu comme une stratégie commerciale, mais il trouve une raison d’être dans chaque film. Quand De Niro constituait pour Scorsese un miroir de lui-même, de ses questionnements existentiels, DiCaprio incarne quelque chose de plus américain. Une vision idéalisée et presque utopique de l’Amérique, que Scorsese, film après film, s’échinera à saper. Dans Gangs of New York, il est l’immigré qui débarque plein d’espoir sur la terre promise ; dans Aviator, il est le wonder boy, l’entrepreneur séducteur à qui, en apparence, tout réussit dans la vie ; dans Les Infiltrés, c’est un type tourmenté, car il vient d’une famille mafieuse, mais il entre dans la police par souci de justice, pour faire le bien ; dans Le Loup de Wall Street, c’est un golden boy. Or, à chaque fois, Scorsese nous montre ces types s’autodétruire ou être détruits par un système social.
En lisant votre livre, on comprend que, très tôt, il rêvait d’adapter La Dernière tentation, roman consacré à Jésus, et à quel point la figure christique habite chacun de ses films. Or, comme la figure de Peter Pan dans Hook pour Spielberg, c’est lorsqu’il s’attaque littéralement à ce sujet qu’il fait l’un de ses moins bons films…
OB : Lorsqu’il découvre le livre de Níkos Kazantzákis, que Barbara Hershey lui offre sur le tournage de Bertha Boxcar, Scorsese se dit qu’il a trouvé l’œuvre ultime pour se frotter à Jésus. Le problème est qu’il n’est jamais aussi maladroit que lorsqu’il s’attaque frontalement à la religion. Tout à coup, il perd ses moyens. À revoir La Dernière tentation du Christ aujourd’hui, on n’est parfois pas loin de visionner un nanar ! Certes, il l’a fait dans des conditions budgétaires catastrophiques mais certains choix posent question, comme les apôtres qui parlent avec l’accent de Little Italy... Pareil pour Silence : il n’y a aucune nuance dans les deux systèmes religieux qui s’affrontent, on est toujours du côté du personnage d’Andrew Garfield. On retrouve un discours ultra-catholique jusqu’à ce plan final avec le crucifix au fond de la main... Élément que Scorsese a complètement inventé. Je crois qu’il s’est radicalisé dans son catholicisme, jusqu’à une posture presque mystique.
NS : Je ne dirais pas qu’il est tétanisé par rapport à son sujet. Dans La Dernière tentation du Christ, justement, il tente des choses quasi expérimentales. Il essaie de plonger une forme très européenne, presque pasolinienne, dans le cinéma des années 1980, avec ce côté « choc » et qui passe, entre autres, par la musique de Peter Gabriel. Si le film est parfois maladroit, c’est par son zèle esthétique. Sur la forme, Scorsese est un peu passé à côté mais ce que raconte le film est très intéressant. Il cherche l’homme en Jésus, son humanité sans le divin – ce qui est cohérent et rejoint ses précédentes œuvres.
Scorsese a toujours eu un rapport contrasté et constructif à la foi. Il a été éduqué dans la religion catholique, il aurait pu virer prosélyte mais a préféré s’interroger, se poser des questions. Il a même, un temps, rejeté l’Église, notamment quand les prêtres soutenaient l’engagement américain au Vietnam. Il a donc beaucoup évolué et s’est éloigné du dogme. Cela dit, il a récemment signé Silence et produit une série sur les saints pour la chaîne Fox parce que c’est un vieil homme qui se rapproche de la mort et qui a, il faut le savoir, une femme très diminuée, en fauteuil roulant, souffrant de la maladie de Parkinson. Cette idée du vieillissement, on la retrouve aussi à la fin de The Irishman, quand De Niro en fauteuil roulant, rumine sa petitesse et sa lâcheté, abandonné de tous.
Puisque votre livre s’intitule Scorsese, la totale, vous revenez aussi sur ses projets pour la télévision, comme vous l’aviez fait avec Spielberg. Qu’a trouvé Scorsese à la télé, et en quoi la vision du médium des deux cinéastes est-elle différente ?
NS : Spielberg a été formé à la télévision, elle a vraiment été sa fac de cinéma, et c’est quelque chose qu’il assume encore. À l’inverse, je pense que, à ses débuts, pas une seconde Scorsese n’a pensé à faire de la télé. Il a commencé en tant que monteur sur des documentaires musicaux. Ce qui a nourri Scorsese, c’est le cinéma indépendant, il voulait être un auteur, un artiste. Il est venu plus tard à la télévision – et aux plateformes –, une fois qu’il avait assis sa carrière et était devenu producteur, une fois sa statue de Commandeur de la cinéphilie et de l’auteurisme hollywoodien érigée. Il a lancé de nombreux projets, même s’il s’y implique de manière inégale.
OB : C’est son grand problème, qu’il a reconnu au moment de l’échec de Vinyl : Scorsese aime bien être partout et nulle part à la fois. Il s’imagine que coproduire une série, réaliser son pilote et en assurer le service après-vente suffira à en assurer la pérennité. Après cet échec, il a lui-même reconnu qu’il aurait dû réaliser tous les épisodes, citant en exemple l’implication de Paolo Sorrentino sur The Young Pope.
.
C’est aussi lié au fait que, comme vous le dites, Martin Scorsese est aujourd’hui devenu une marque, un label.
NS : Il est souvent présenté comme « le plus grand cinéaste vivant ». Il fait énormément pour le patrimoine et la restauration des films à travers son association la Film Foundation, il apparaît fréquemment sur des bonus DVD pour expliquer à quel point telle œuvre est géniale ou méconnue, il soutient des cinéastes débutants comme Joanna Hogg ou Ari Aster... Et, en même temps, il est devenu une marque prestigieuse, un cinéaste qui coûte très cher, et a dû se tourner vers Netflix pour financer The Irishman ou encore Apple TV pour Killers of the Flower Moon. On pourrait croire qu’il condamnerait ces plateformes puisque ce n’est pas la salle de cinéma, et pour autant il en a besoin pour faire exister ses films. C’est paradoxal, presque schizophrénique. Avant, Scorsese s’interrogeait sur le bien, le mal, sur sa violence intérieure ; aujourd’hui, il est ce cinéaste qui, à la fois, promeut l’expérience de la salle et a besoin de Netflix pour monter ses films.
OB : Il est clairement devenu une marque, il a bien retenu les leçons d’Hitchcock puisqu’il est devenu lui aussi une silhouette, avec sa petite taille, ses sourcils bien garnis et son débit mitraillette.
C’est comme cela qu’il apparaît dans la récente série The Studio, par exemple.
NS : C’est là qu’on voit que Scorsese a beaucoup d’humour ! Il a eu raison de jouer dans cette série, d’abord parce qu’elle le fera découvrir à un public plus jeune, ensuite parce qu’elle raconte vraiment son statut à Hollywood : on va le chercher pour réaliser un film comme on ferait appel à une marque de prestige, lui pense que ce sera une œuvre personnelle dans laquelle il parlera des sectes et de l’Amérique, puis on lui impose un sponsor, la boisson Kool-Aid, le projet devient un blockbuster à ses dépens et il finit en larmes sur l’épaule de Charlize Theron… Cela dit donc quelque chose de très juste sur ce qu’il incarne aujourd’hui.
– Éditions E/P/A, publié le 5 novembre 2025
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.