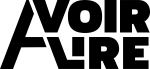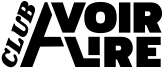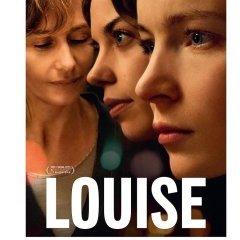Le 18 décembre 2025

- Distributeur : Apollo Films
Nous avons échangé avec le fondateur de la société de distribution Apollo Films lors du Festival du Francophone d’Angoulême.
Professionnel majeur et reconnu de l’industrie du cinéma français, François Clerc revient sur sa carrière, de ses débuts chez Gaumont, où il a accompagné la sortie de phénomènes tels que Les visiteurs ou Intouchables, à la fondation d’Apollo Films, et partage son enthousiasme pour la comédie.
Vous avez débuté votre carrière en tant qu’exploitant chez Gaumont en 1992. Soit l’année précédant le triomphe des Visiteurs, une production maison. Comment avez-vous vécu ce phénomène ?
Je me souviens qu’un grand séminaire avec les directeurs des cinémas Gaumont s’est déroulé lors de la semaine ayant suivi mon arrivée. Les visiteurs y a été montré et nous savions que nous tenions là une grande comédie populaire de qualité… mais sans nous douter du phénomène qu’elle allait engendrer. Après tout, nous n’étions qu’une vingtaine de professionnels. Or, un film n’explose véritablement qu’auprès du public. Je me souviens avoir pris le direction des cinémas d’Angers, les Variétés et le Colisée, lors de la sortie du film. Il faisait chaque semaine plus d’entrées que les nouveautés. Et cela a duré quatre mois. On laissait une chance aux nouveautés de se faire une place chaque mercredi en les plaçant dans la plus grande salle, mais constatant que Les Visiteurs faisait toujours plus d’entrées au fil des semaines, on le remettait dans la grande salle. Cela nous est arrivé à nouveau avec des films comme Le dîner de cons ou Intouchables. Ce sont des succès qui se sont inscrit sur la durée. Intouchables a enregistré plus d’un millions d’entrées chaque semaine pendant dix semaines. Le début des années 90 a été une période faste pour les salles de cinéma, entre Les Visiteurs, Jurassic Park ou Le fugitif. Ce qui est intéressant lorsqu’on dirige un cinéma, c’est que lorsqu’on visualise un film, on visualise aussi la salle dans laquelle on l’a montré. Je me rappelle de la sortie de Seven en 1995 et des visages livides des spectateurs lorsqu’ils sortaient du cinéma. Ils étaient vraiment marqués.
Comment expliquez-vous certains succès hors normes que vous avez pu connaître, comme celui d’Intouchables notamment ?
Avec 130 ans de cinéma et 240 films français qui sortent en salles chaque année, nous avons observé toutes les trajectoires possibles pour l’exploitation d’un film. Aussi, lorsqu’un long métrage atteint des scores aussi phénoménaux, il n’y a plus aucune logique, plus aucun modèle, plus rien à comparer ou à analyser. Lors de la première présentation de la bande annonce d’Intouchables, nous sentions qu’il pouvait se passer quelque chose. Le carton semblait assurer… mais nous, on en riait. Éric Toledano et Olivier Nakache voulaient se protéger de cela. Ils le prenaient comme un compliment mais pas comme box-office acquis. Ils avaient peur qu’on s’arrête de bosser en anticipant un succès mais nous nous sommes interdits de le faire et nous avons travaillé comme jamais pour amener le film au public. Les médias se sont emballés, notamment pour le duo formé par Omar Sy, dans son premier grand rôle au cinéma, et François Cluzet, un acteur plus installé. On était soufflés par les chiffres mais on se demandait quoi faire de ces résultats tellement ils nous échappaient. Pour l’anecdote, le jour de la sortie, nous avons déjeuné avec toute l’équipe du film dans un restaurant italien à Montparnasse et il se trouve que Jean-Pierre Bacri était installé près de notre table. Éric et Olivier ont profité de cette occasion pour échanger avec lui et j’aime à penser que Le sens de la fête est né ce jour là.
Un succès peut-il aussi s’expliquer selon son époque et son contexte ?
En effet, un succès, c’est la rencontre entre une œuvre et un public à un moment précis. Je donne un exemple concret : il y a eu comme un état de grâce lors de l’élection de Nicolas Sarkozy… qui a été suivi comme une sorte de dépression, un retour à la réalité qui est qu’aucun politique ne pourra jamais sauver le monde et résoudre tous les problèmes à lui seul. C’est dans ce contexte que Bienvenue chez les Ch’tis a triomphé. Les spectateurs avaient besoin de légèreté, de rire, et de revenir à des valeurs terriennes, à des choses simples, qui nous touchent et nous rassemblent. Cela a été la même chose pour Un p’tit truc en plus l’année dernière. C’est une vraie comédie de personnages, extrêmement bien écrits et dessinés, auxquels on s’attache immédiatement et, probablement, qui nous ressemblent.
La comédie est un genre qui peut être très noble lorsqu’elle est bien conçue. Pourtant, depuis quelques années, et notamment depuis la crise sanitaire, on note que peu de comédies parviennent à tirer leur épingle du jeu lors de leur sortie en salles. Elles triomphent davantage lors de leur diffusion télévisée. Alors, les comédies sont-elles nécessairement toutes destinées à la salle ?
Il n’y a rien de plus binaire que la comédie. C’est drôle ou ce n’est pas drôle. On rit ou on ne rit pas. Et si on sourit, c’est que ce n’est pas drôle. C’est le genre ultime de la salle de cinéma. J’ai eu l’occasion d’accompagner la sortie des films de Francis Veber lorsque je travaillais chez Gaumont. Il nous imposait de ne jamais sortir ses films dans la plus grande salle d’un cinéma, mais dans la deuxième. Sa stratégie était imparable car il n’y a rien qui fait plus rire le public qu’un public qui rit. Si, dans une salle, vous êtes au dernier rang et que vous n’entendez pas les rires du premier rang, le film perd de sa valeur. Francis Veber préférait une salle plus petite et pleine qu’une salle plus grande et à demi-pleine. Les rires doivent être entendus de tous. Cela génère un effet d’entrainement. Francis Veber est un homme de théâtre. Il a cette culture là.
J’ai sorti aussi Père et fils de Michel Boujenah qui vient du spectacle vivant. Il m’expliquait que le cinéma était pour lui à la fois génial et frustrant. En effet, sur scène, il tentait une vanne et si le public riait, c’était dans la poche, mais s’il ne riait pas, il changeait la vanne lors du spectacle suivant. Il disait que le cinéma était comme un écho. Il écrivait une vanne, la faisait interpréter, la filmait, la montait et il fallait attendre six mois, avec la sortie en salles, pour savoir si la vanne était drôle ou non. Pour Le dîner de cons, ce sont des années de rodage du spectacle original qui ont permis à Veber d’avoir chaque seconde de son film à l’oreille. Il avait tellement son film en tête que lorsqu’il nous le livre, il dure moins de 70 minutes. Et sous la pression des distributeurs étrangers, auprès desquels nous nous étions engagés contractuellement à livrer un film d’au moins 75 minutes, il a fallu tourner toutes les scènes d’avant générique pour rallonger le film. Je me souviens aussi que lors des projections test, Veber ne regardait jamais l’écran mais écoutait la salle, la musicalité des vannes et des rires.
Il y a tant de comédies françaises chaque année que l’on est tenté de penser qu’il est facile de les financer. Est-ce vraiment le cas ?
La France croit énormément en la comédie. Pour qu’un cinéma local marche, il faut que la comédie marche. Si je demande aux spectateurs de me citer leurs comédies préférées, ils citeront beaucoup de films français car c’est le genre le plus localisé sur le plan culturel. Trois des premiers exploitants français, Pathé, UGC et CGR, via Apollo, sont aussi des producteurs-distributeurs de comédies. Il y a donc ce désir de conserver un public qui vient voir des films français dont la quintessence est la comédie… qui demeure le genre le moins bien noté par la critique alors que c’est le genre le plus difficile à écrire.
Aujourd’hui, le circuit de financement du cinéma n’est composé que de comités de lecture, aussi bien dans les chaînes de télévision que les SOFICA ou les régions. Donc un projet de film passe par au moins dix ou quinze comités de lecture qui ont lu ou pas le projet en question et vont donner leur avis. Or, il est difficile de savoir ce qu’une comédie va donner. Voyez le célèbre « Okay » de Jacquouille dans Les visiteurs. À la lecture, cela peut sembler lourd et ridicule. Qui pouvait prévoir que ça allait devenir culte ? Avec un auteur comme Francis Veber, qui demeure un fin dialoguiste, cela peut être plus facile. Mais dans les univers de La bande à Fifi, des Deguns ou des SEGPA, on ne peut guère se projeter. À notre niveau, on peut faire confiance aux auteurs et tenter des choses… mais comment convaincre les dix comités de lecture nécessaires ? Voyez comme c’est complexe de faire une comédie, de l’écrire, de la jouer, de la tourner, et de la financer !
Quelle analyse portez-vous sur l’évolution de la comédie à la française au cours des dernières années ?
Il y a toujours eu plusieurs familles de comédies. Tout d’abord les comédies à texte, comme celles de Michel Audiard ou Francis Veber. Ensuite, les années Canal+, avec un humour noir et un style un peu haut de gamme, comme OSS 117 ou Astérix ou Obélix : Mission Cléopâtre, avec la puissance d’écriture d’Alain Chabat. Aujourd’hui, on semble revenir à des choses plus simples et humaines, où l’on rit avec les autres plutôt que des autres. À la vérité, la clé reste la sincérité. Artus est hyper sincère avec Un p’tit truc en plus. Tout comme Dany Boon avec Bienvenue chez les Ch’tis. Ou Philippe Lacheau qui conçoit des films très visuels qui rappellent ce qu’il faisait sur le plateau de Nul part ailleurs. C’est notre responsabilité de savoir si un auteur est sincère ou non.
Vous-même, avec votre société Apollo Films, vous vous êtes notamment spécialisé dans la comédie. C’est votre fer de lance…
Nous avons fait beaucoup de comédies décalées, comme Barbaque ou Zaï Zaï Zaï Zaï, qui ont fait plus rire la critique que le public. Des comédies sociales comme Les invisibles ou Docteur ? nous ont également réussi. Après tout, la comédie n’est que « la forme » pour raconter une histoire, qui tient souvent du vivre-ensemble. Je me souviens d’un article du Monde lors de la sortie d’Intouchables, où une journaliste, qui avait découvert le film dans un cinéma de banlieue, décrivait la diversité des spectateurs, jeunes, vieux, seuls ou en couple, qui riaient à l’unisson. C’est la quintessence de ce film qui rassemble et célèbre ce vivre-ensemble. C’est le buddy movie ultime. On n’est pas du même monde, mais un enjeu nous rassemble et parce qu’on est différent et qu’on s’allie, on est plus fort à deux que dans nos individualités. C’est une notion qui répond à l’acte même d’aller au cinéma, de partager quelque chose avec des gens qu’on ne connaît pas ; et si on rit ensemble, on donne de la valeur au film. C’est de la sociologie pure.
Malgré votre intérêt pour la comédie, vous semblez vous permettre quelques pas de côté. C’est notamment le cas cette année où vous avez sortez trois drames particulièrement réussis, Le gang des Amazones, Louise et Qui brille au combat…
Tout est une question de plaisir et ce plaisir est lié à deux choses. Tout d’abord, les rencontres humaines. Puis, les histoires que nous avons envie de proposer au public. Quand nous construisons notre line up, nous nous attachons à ce qu’est Apollo. Donc nous cherchons d’abord des comédies, puis autre chose. Il y a 2 200 cinémas en France, mais que 250 multiplexes. Quand nous sortons une comédie populaire ou un film d’action, 95 % de nos entrées sont concentrées sur ces 250 multiplexes. Nous pourrions faire cela toute l’année et n’avoir que cinq programmateurs pour couvrir tout le marché. Mais nous estimons que nous devons travailler avec ces 2 200 cinémas. Nous avons donc besoin de films qui nous permettent d’échanger avec d’autres interlocuteurs. Si nous n’avons pas Qui brille au combat, nous ne pouvons pas aller au Festival de Cannes et vivre une projection aussi émouvante et forte que celle que nous avons vécue. Ensuite, il y a le problème du risque économique. Un film comme Pourris gâtés a fait 500 000 entrées dans un marché complexe de COVID avant de cartonner à la télévision puis sur Netflix où il a été en tête des visionnages dans 62 pays. Nos risques économiques sont diversifiés. Nous devons faire des films pour le cinéma mais qui peuvent avoir aussi une valeur à la télévision, une valeur à l’international, une valeur en VOD. Il y a des films plus adaptés à certains médias plutôt qu’à d’autres.
Justement, en tant que cinéphiles, vous et moi sommes évidemment très attachés à la salle de cinéma. Pour autant, ne pensez-vous pas qu’aujourd’hui, le succès de certaines œuvres pourraient être beaucoup plus important sur une plateforme que dans une salle ? Je pense notamment au film d’action Les orphelins, qui a été un échec au cinéma alors qu’il aurait connu le même « carton » que Balle perdue sur Netflix !
Il faut remettre les choses dans leur contexte. Avant que Balle perdue n’ait connu le triomphe qu’on lui connaît, son producteur l’a proposé à tous les distributeurs du marché, y compris à nous. Le projet n’avait pas beaucoup d’argent et nous lui avons fait comprendre que cela semblait être un film trop petit pour un spectacle de cinéma. Puis il sort sur Netflix où non seulement le film fait un carton, mais il est réussi. Et aujourd’hui, Balle perdue 3 dispose d’un budget supérieur à 20 millions d’euros. Donc Netflix a ouvert une voie et ce film aussi d’ailleurs. On dit toujours qu’il y a un univers économique en place et qu’il suffit d’un film pour changer les règles tant il est plus fort que le système. C’était le cas d’Un p’tit truc en plus puisque le système ne voulait pas du film. Il y a même un fonds d’investissement qui a retiré 50 000 euros la veille de la sortie en salles.
Netflix a donc, en quelque sorte, remplacé EuropaCorp et produit des films d’action d’ampleur. Mais on oublie une chose : c’est que même si les talents apprécient le confort que leur apporte Netflix, notamment un budget conséquent, ils sont tout de même envieux de leurs confrères dont ils voient les œuvres sortir en salles, avec toute l’excitation, l’adrénaline et le stress que cela implique. Ils aimeraient retrouver cela car une sortie sur une plateforme n’a rien à voir avec une sortie en salles. Ils savent que la salle imprime quelque chose de plus impactant. Cette année, le manque de succès s’explique par l’absence de films susceptibles d’attirer les spectateurs occasionnels et réguliers. On manque d’offre et il y a aussi un resserrement économique. Les spectateurs font les choix et quand il n’y a pas d’évidence, ils ne viennent pas.
Propos recueillis par Nicolas Colle
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.